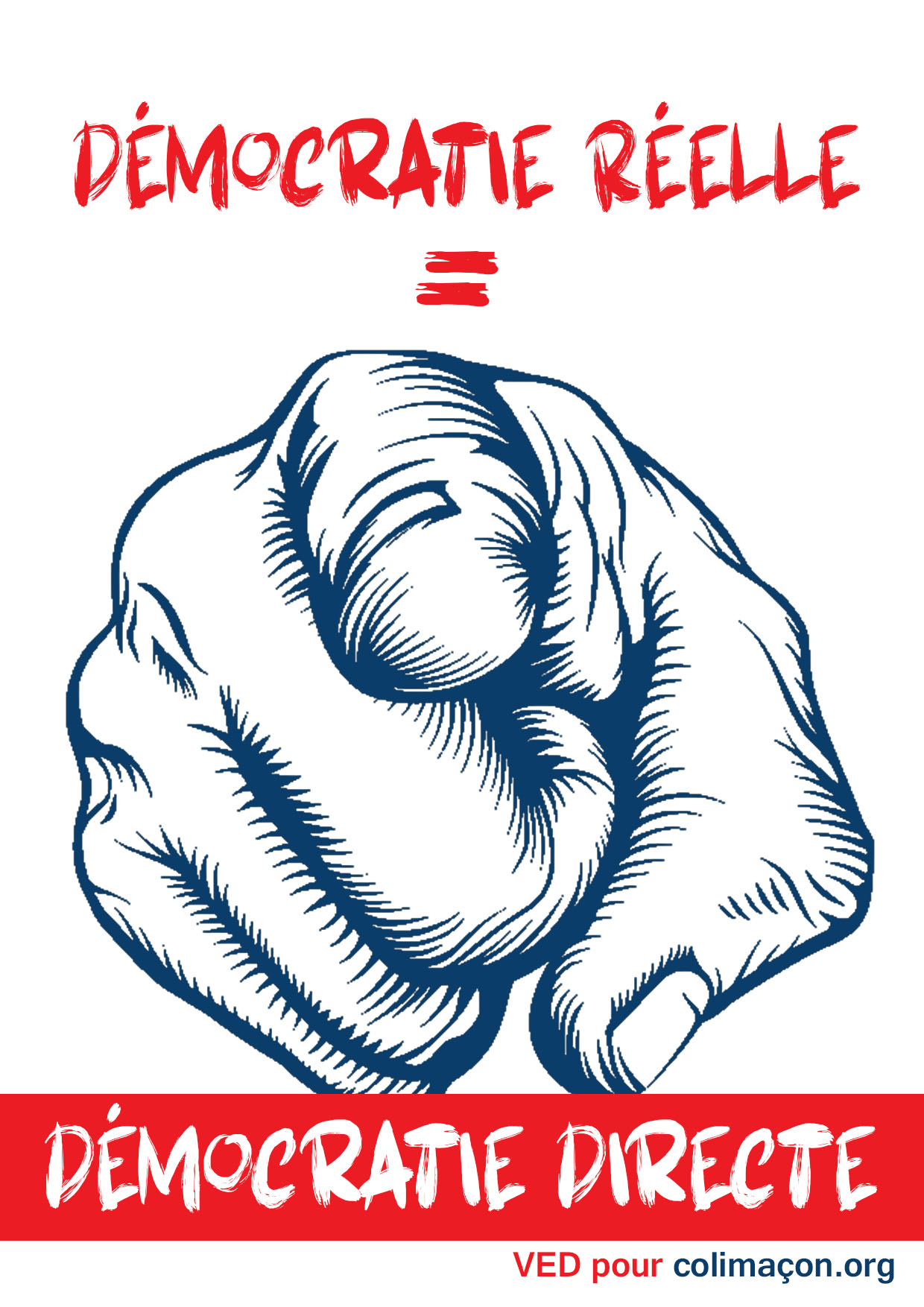Qu’est-ce que l’éthique ? Comment la distinguer de la morale ? La société peut-elle bénéficier globalement d’individus dépourvus d’éthique ? Nos élites sont-elles plus ou moins exemplaires qu’avant ? La démocratie directe présupose-t-elle la généralisation d’une éthique individuelle irréprochable ?
Ethique et morale
Les concepts d’éthique et de morale s’utilisent souvent indifféremment et recouvrent un ensemble de valeurs positives. Pour opérer la distinction, on associe généralement l’éthique à l’individu et la morale à un groupe social. L’éthique se traduit par un questionnement qui cherche à trouver le juste dans une circonstance donnée. Cela peut se résumer à la place que chacun attribue à la frontière qui sépare le bien du mal. Le principal ennemi de l’éthique est le détournement du regard. Bien entendu, l’éthique individuelle varie en fonction de chaque individu, tout comme la morale est différente suivant le lieu ou l’époque. Par exemple, les pays d’Europe du Nord ont des codes moraux généralement considérés comme stricts au regard du personne politique. Rappelons nous de cette ministre de la culture en Suède poussée à la démission en 2006 (Cecilia Stegij Chilo) pour avoir omis de payer la redevance télévisuel et déclarer sa nounou.
La fable de l’anti-éthique
Dans la « Fable des Abeilles (1723), Mandeville soutient que la guerre, le vol, la prostitution, l’alcool et les drogues, la cupidité, etc. contribuent finalement « à l’avantage de la société civile ». « Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourrez l’être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens » Ce raisonnement qui sera ramassé dans la formule « Vice privée, vertu publique » s’avère proche des théories du ruissellement très en vogue à la tête de l’Etat.
Une version cinématographie de ce principe se retrouve dans la bouche d’un trader décomplexé (Gordon Geiko) du film Wall Street : Greed is good ! (soyez cupides !)
Une formule prend le contrepied de cette ruche corrompue mais prospère en évoquant « l’infirmité morale du capitalisme ».
L’hommes est-il naturellement bon ?
Dans La morale anarchiste (1889), Pierre Kropotkine nous livre sa vision de l’éthique (confondue ici avec morale), vision proche de la position de Rousseau : « L’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt ». Le prince de l’anarchie résume l’éthique individuelle par cette formule : « Traite les autres comme tu aimerais à être traité par eux dans des circonstances analogues ». « Le sens moral est en nous une faculté naturelle, tout comme le sens de l’odorat et le sens du toucher ». De ce principe découle selon lui l’entraide ou la solidarité, exact opposé du principe darwinien de lutte pour l’existence. L’ensemble du système d’éthique individuelle repose sur le principe d’égalité entre les humains. Que cette égalité soit bafouée et les comportements naturels sont entravés. Kropotkine peut donc conclure qu’une société libérée de ses entraves permettrait à chacun de retrouver son sens éthique inné. En abattant capitalisme, religion, justice, gouvernement, on libère en quelque sorte la morale intrinsèque de l’homme. « En jetant par-dessus bord la Loi, la Religion et l’Autorité, l’humanité reprend possession du principe moral qu’elle s’est laissé enlever, afin de soumettre à la critique et de le purger des adultérations dont le prêtre, le juge et le gouvernement l’avaient empoisonné et l’empoisonnent encore. » Faut-il en vouloir à Jack l’Eventreur ou au propriétaire du misérable taudis de sa victime qui a cherché à lui faire payer les quelques sous de son loyer ? nous dit en substance Kropotkine. Quand on pense au juge, garant de la morale bourgeoise, qui a envoyé au bagne froidement quantité de miséreux, n’est-on pas détourné de l’objet de notre indignation ?
Les continuateurs de la pensée de Kropotkine, s’activant à la mise en œuvre des Kibboutz ne pensaient pas autrement. L’un d’eux témoigne dans les années 1920 à propos du premier Kibboutz (Degania) et de l’éventualité qu’un membre s’adonne à la paresse tout en profitant du salaire égal pour tous : « si cela arrivait, nous cesserions aussitôt d’aimer le fautif ».
Sommes nous plus ou moins éthiques qu’avant ?
A la lecture d’un journal ou du site web d’une association comme Anticor, on peut légitimement s’interroger sur l’érosion éthique de notre société.
Et sans doute aurions-nous tort de considérer ce biais cognitif comme une vérité anthropologique. Les « casseroles » existent de toute éternité : de l’arrestation du surintendant Nicolas Fouquet par Louis XIV au scandale de panama sous la IIIè République en passant par l’affaire des diamants de Bokassa pour ne parler que de l’ère moderne, les exemples abondent et ne permettent pas de prétendre au déclin de l’éthique bien que cela soit difficilement quantifiable.
Certains ont défendu un point de vue complémentaire à cette stabilité de l’ère moderne. Castoriadis (Une société à la dérive 2005) donne pour point de bascule l’apparition du capitalisme (que certains font remonter à la renaissance). « Le capitalisme vit en épuisant les réserves anthropologiques constituées pendant les millénaires précédents (honnêteté, dévotion au travail, attention aux autres, etc.). De même qu’il vit en épuisant les réserves naturelles. » Castoriadis adopte un point de vue inverse à celui de Kropotkine, arguant que la morale est un leg de valeurs anciennes, notamment religieuses, que le capitalisme se plaît à piller, là ou Kropotkine affirme que le sens éthique est un état naturel de l’homme que la société entravée par la religion et l’Etat ne fait que pervertir.
S’il est donc difficile de conclure sur le déclin ou la stabilité de l’éthique à l’ère moderne ou sur un temps plus long, on trouve de nombreux penseurs, tel Polyani s’appuyant sur l’anthropologie et l’histoire, pour réfuter l’idée moderne que la nature de l’homme est utilitariste (dépourvu d’éthique).
Des dirigeants exemplaires ?
Peut-on attendre des élites un comportement exemplaire ou nos élites ne sont-elles que le reflet de notre société dans son ensemble ?
Cincinnatus citoyen romain qui sauva Rome par deux fois avant de retourner labourer ses champs fait figure d’exception anthropologique au même titre qu’un De Gaulle renonçant par deux fois lui aussi au pouvoir par conviction politique (chef de gouvernement en 1946 et chef d’Etat en 1969).
Les élites se révèlent sans doute ni plus, ni moins dépourvus d’éthiques que tout un chacune. Une différence majeure sépare toutefois les élites du reste : la proximité de l’argent et les tentations que cela suppose. Robespierre à ce sujet cisela cette formule : « Les riches ont nommé leur intérêt particulier, intérêt général. »
Par ailleurs, les vulgaires citoyens et leurs élites ont en commun une humanité par définition complexe et chargée de contradiction. On peut penser que Nicolas Hulot a fait preuve d’une exigence éthique hors norme en donnant sa démission de ministre de l’écologie, tournant le dos à un poste prestigieux. Et c’est pourtant le même homme qui a été accusé par 6 femmes de violences sexuelles (il est toujours présumé innocent). Et ce n’est bien entendu qu’un exemple parmi d’autres.
La sélection naturelle des moins éthiques
La société favorisait-elle la promotion d’individus sourds à leur conscience voire sans conscience ? Si avec Castoriadis, on postule que le capitalisme favorise le déclin de l’éthique, peut-on tenter d’en trouver les causes ?
Certains ont parlé de darwinisme social pour qualifier les mécanismes à l’œuvre dans notre société moderne. En cela, le capitalisme favoriserait la sélection des individus à la fois les plus malins ET indifférents aux dilemmes éthiques. Les promesses de Bernard Tapie aux salariés des entreprises rachetées à la barre des tribunaux de commerce n’ont-ils pas fait les frais de ce type de profil ? Ainsi, parmi d’autres exemples, déclara-t-il en novembre 1984 aux 244 salariés de l’usine Wonder de Lisieux : « Nous mettrons les moyens qu’il faut pour que Lisieux fonctionne. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de Wonder. Je suis sûr que l’an prochain, nous ferons de l’argent ». 10 mois plus tard, le site fermait ses portes. 4 ans plus tard, il empochait une plus-value de 72 millions d’euros en revendant Wonder à un groupe américain.
Au cœur de cette problématique éthique du capitalisme : l’efficacité. Si la recherche d’efficacité est nécessaire, le caractère absolu de cette quête pose problème selon Jacques Ellul dénonçant le « monothéisme de l’efficacité ». Or, Walter Benjamin nous dit bien que « Pour pouvoir accomplir quelque chose contre le capitalisme, il est indispensable, avant tout, de quitter sa sphère d’efficacité, parce que, à l’intérieur de celle-ci, il est capable d’absorber toute action contraire. »
Les conclusions pour la démocratie directe
Si l’éthique des élites équivaut celle des citoyens dans leur ensemble, pourquoi miser sur un régime de démocratie directe reposant sur le plus grand nombre ?
Une première réponse tient justement dans le nombre. Une infinité d’individus dénués d’éthique vaut mieux qu’une poignée tout autant dévoyée mais dont les intérêts personnels les rendent influençables. Voter l’abrogation du droit à la fortune s’avère évidente lorsqu’on est pauvre. Voter pour des mécanismes de justice est plus facile sans fortune personnelle. Le principe utilitariste de la fable des abeilles est ici renversé au profit d’une société amorale et égalitaire.
Cette première réponse utilitariste ne s’avère toutefois pas suffisante. Certains problèmes nous concernent tous, riches ou pauvres. Personne ne semble avoir intérêt à les résoudre. Par exemple, le réchauffement climatique ou l’extinction massive des espèces paraissent distantes et théoriques à beaucoup : riches ou pauvres. De telles menaces supposent qu’une éthique altruiste prévale chez la majorité des citoyens au pouvoir (riche ou pauvre) pour laisser à nos enfants une planète préservée. A n’en pas douter pour reprendre l’argument de Kropotkine, dans une situation d’égalité, on peut s’attendre à faire ressortir la nature bonne de l’homme capable de remettre en cause son confort matériel à court terme (si on considère la décroissance comme une nuisance et non comme une opportunité). Enfin, avec la démocratie directe, la conquête du pouvoir se trouve relégué au second plan. Tirage au sort et élection sans candidat affaiblissent drastiquement le ressort de l’ambition personnelle. Les mandats révocables et la précarisation des postes électifs excluent les promesses intenables et donc les comportements électorales dévoyés. Avec la démocratie directe, une société plus apaisée favorisant une éthique de la non puissance ne serait-elle pas envisageable ?