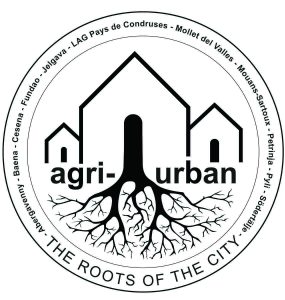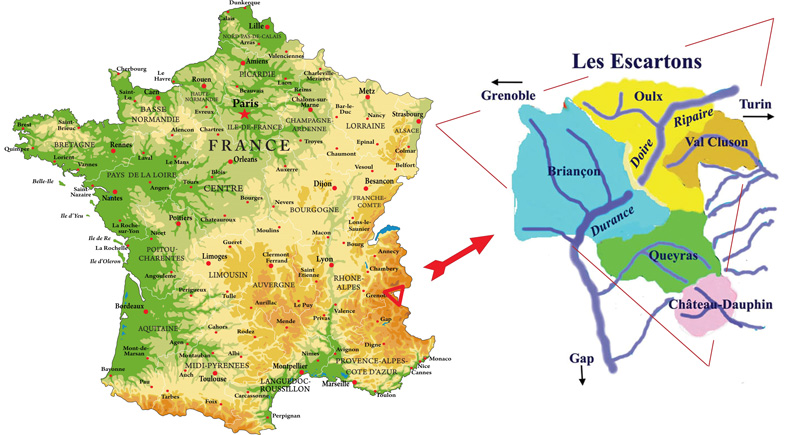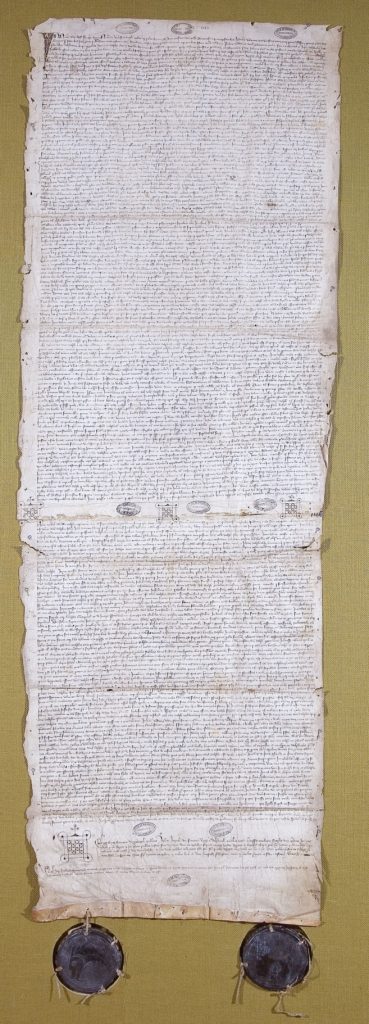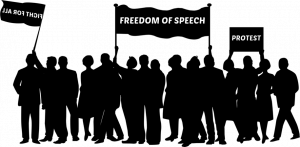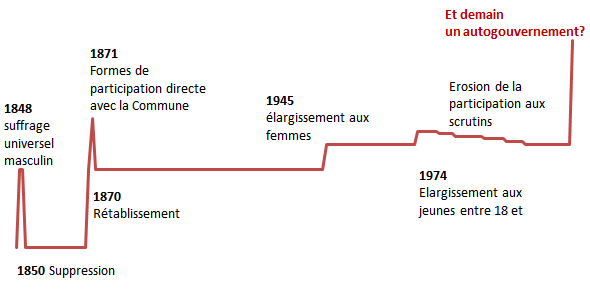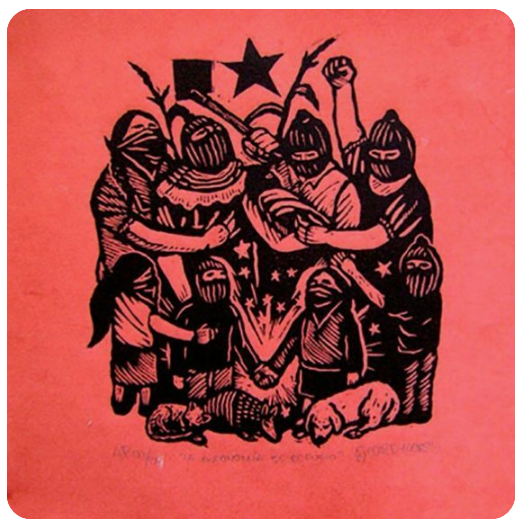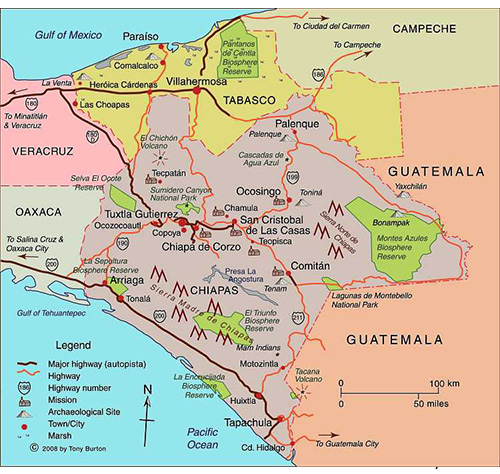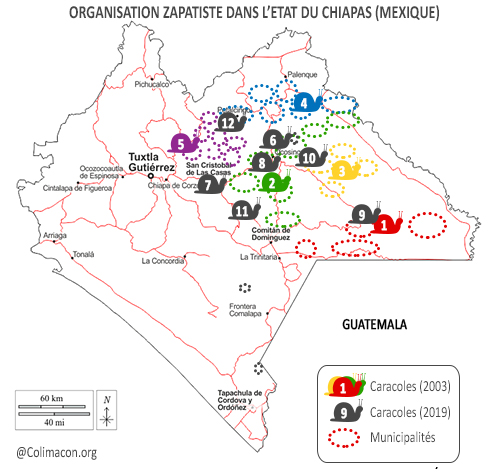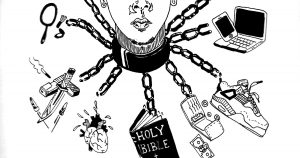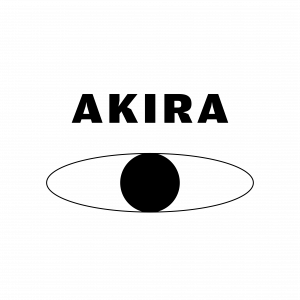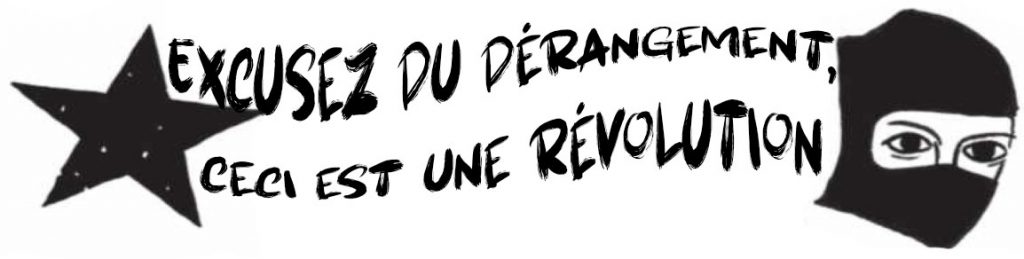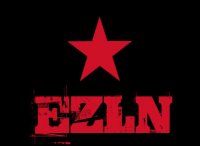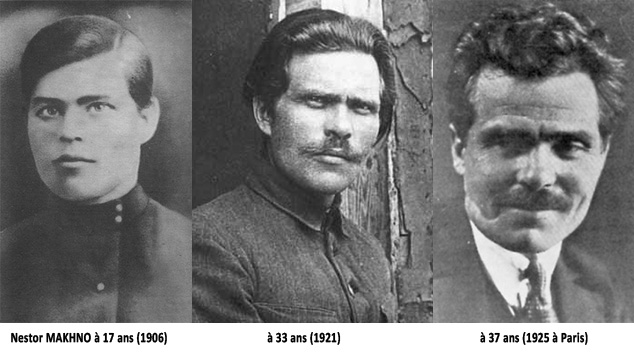A partir de quelles règles s’est construite l’expérience zapatiste? Comment ce socle de lois a-t-il été conçu? Quels aspects de la vie quotidienne sont pris en compte dans ce texte?
Nous avons vu la « genèse » de la révolution zapatiste dans cet article, attardons-nous à présent sur les « lois divines » rendues publiques peu avant l’insurrection: les lois révolutionnaire. Ce corpus diffusé en décembre 1993 ne tient pas lieu de constitution (voir cet article sur l’absence de constitution), mais édicte des règles de transition à appliquer sur les territoires sous le contrôle des zapatistes.
Au commencement, donc, était l’EZLN, armée de libération soutenue par une grande partie de la population locale. Cette armée commandée par le comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI) et dont Marcos est le chef militaire en même temps que porte-parole édicte donc un texte portant à la fois les principales revendications bientôt regroupées dans la formule Liberté, Justice, Démocratie et les principales règles permettant une vie décente pour les populations locales.
En résumé, ces lois révolutionnaire visent à :
- Limiter les dérives autoritaires ou mercantiles de l’armée ou de fractions de celle-ci.
- Interdire l’immixtion des militaires dans les affaires civiles et notamment les processus de démocratie.
- Permettre à l’armée de subsister sur les territoires contrôlés en bénéficiant de logements et de vivres, sans abus ou disproportion par rapport aux conditions de vie des populations locales.
- Mettre en place des impôts révolutionnaires sur les territoires contrôlés par les zapatistes avec des taux importants pour les grands (20% des revenus) et une exonération pour les petits.
- Abolir les impôts et taxes du mauvais gouvernement.
- Promouvoir la tenue d’élections libres et démocratiques, et responsabiliser les élus : compte-rendu régulier à la population, responsabilité de l’argent public dépensé.
- Déposséder les propriétaires d’un terrain excédant 100 hectares en mauvais état ou 50 hectares en bon état pour qu’il ne lui soit laissé que le minimum autorisé. Ces terres vont en priorité aux paysans sans terres.
- Exproprier les grandes entreprises agricoles au profit de coopératives.
- Reboiser, préserver l’eau, les forêts.
- Mettre en place de centres de commerces pour un achat des denrées au juste prix et une revente à prix équitable.
- Bâtir des centres de santé pour tous avec des médicaments gratuits pour le peuple, des centres de loisirs pour tous, des écoles gratuites, des centres de construction pour aider à bâtir des maisons et infrastructures, des centres de services pour fournir au peuple électricité et aménagements.
- Permettre l’occupation des bâtiments publics et des grandes demeures par le peuple.
- Suspendre les loyers pour les locataires occupant un logement depuis plus de 15 ans et réduire à 10% des revenus du chef de famille pour les autres.
- Interdire la discrimination des femmes, en particulier dans la gestion des affaires de la communauté ou à tous les grades de l’armée.
- Garantir leur droit de choisir un époux, de travailler, de décider du nombre d’enfants qu’elles veulent.
- Obliger les entreprises étrangères à payer leurs employés en monnaie nationale au tarif horaire équivalent à celui qu’elles pratiquent en dollars à l’étranger.
- Revoir les salaires, procurer une assistance médicale gratuite payée par les patrons, mettre à disposition des actions de l’entreprise au prorata de l’ancienneté.
- Réguler des prix des denrées de première nécessité.
- Fournir un logement et une nourriture gratuits pour les personnes âgées sans famille.
- Garantir les pensions de retraites au niveau du salaire minimum.
- Libérer tous les détenus à l’exception des assassins, des violeurs et des dirigeants du trafic de drogue.
Voici ce texte.
Paru dans le premier numéro de « Le réveil mexicain », organe d’information de l’EZLN (Armée de libération zapatiste au Mexique) en décembre 1993[1].
Mexicains ! Ouvriers, paysans, étudiants, profesionistas[2] honnêtes, chicanos[3] progressistes d’autres pays, nous avons entrepris la lutte qu’il nous faut mener pour obtenir ce que l’État mexicain n’a jamais voulu nous accorder : le travail, la terre, un toit, l’alimentation, la santé, l’éducation, l’indépendance, la liberté, la démocratie, la justice et la paix.
Nous avons passé des centaines d’années à réclamer des promesses jamais tenues (et à y croire), on nous a toujours demandé d’être patients et de savoir attendre des temps meilleurs. On nous a conseillé la prudence, et on nous a promis que l’avenir serait différent Or nous avons vu que non : tout est pareil ou pire que ce que vécurent nos grands-parents et nos parents. Notre peuple continue de mourir de faim et de maladies curables, en proie à l’ignorance, l’analphabétisme et l’inculture. Et nous avons compris que si nous ne nous battons pas, nos enfants à leur tour auraient à en passer par là. Et ça n’est pas juste.
Peu à peu, le besoin nous a rassemblés et nous avons dit : ÇA SUFFIT. Nous n’avons plus le temps, ni l’envie d’attendre que d’autres viennent résoudre nos problèmes. Nous nous sommes organisés et avons résolu D’EXIGER CE QUI NOUS EST DÛ LES ARMES À LA MAIN, ainsi que l’ont fait les meilleurs fils du peuple mexicain au long de son histoire.
Nous avons engagé les combats contre l’Armée fédérale et les autres forces de répression ; nous sommes des milliers de Mexicains prêts à VIVRE POUR LA PATRIE OU MOURIR POUR LA LIBERTÉ dans cette guerre nécessaire pour tous les pauvres, les exploités et les miséreux du Mexique et nous n’arrêterons pas avant d’avoir atteint nos objectifs.
Nous vous exhortons à rejoindre notre mouvement car l’ennemi que nous affrontons, les riches et l’Etat, cruel et sans pitié, ne mettra aucun frein à sa nature sanguinaire pour en finir avec nous. Il faut lui donner la réplique sur tous les fronts, et c’est pourquoi votre sympathie, votre appui solidaire, votre capacité à divulguer notre cause, à adhérer à nos idéaux, à prendre part à la révolution en encourageant vos concitoyens à se lever, où que vous soyez, seront des facteurs très importants jusqu’au triomphe final.
LE RÉVEIL MEXICAIN est le journal de l’Armée zapatiste de Libération nationale, son rôle est d’informer notre peuple du déroulement de la juste guerre que nous avons déclarée à nos ennemis de classe. Dans ce premier numéro, nous présentons la Déclaration de guerre que nous adressons à l’Armée fédérale, et nous donnons les ordres auxquels doivent obéir les chefs et officiers des troupes de l’EZLN lors de leur progression sur le territoire national. Nous présentons aussi les Lois révolutionnaires qui s’instaureront, avec le soutien des peuples en lutte, dans les territoires libérés pour en garantir le contrôle révolutionnaire et seront les fondations sur lesquelles bâtir une nouvelle Patrie.
VIVRE POUR LA PATRIE OU MOURIR POUR LA LIBERTÉ
Instructions aux chefs et officiers de l’EZLN
Les ordres suivants doivent être obligatoirement suivis par tous les chefs et officiers des troupes sous la direction de l’Armée zapatiste de Libération nationale.
Premièrement – Vous opérerez en accord avec les ordres que vous recevrez du Commandement général ou des commandements du front de combat.
Deuxièmement – Les chefs et officiers opérant militairement dans des zones isolées ou rencontrant des difficultés de communication avec les commandements devront effectuer leurs tâches militaires, combattre constamment l’ennemi, selon leur propre initiative, en veillant à favoriser la progression de la révolution là où ils se trouvent.
Troisièmement – Ils devront remettre des rapports de guerre à chaque fois que ce sera possible et au moins de façon mensuelle à leurs commandements respectifs.
Quatrièmement – Il leur faudra, dans la mesure du possible, assurer le bon ordre des troupes, particulièrement lors de l’entrée dans des agglomérations, donnant toutes sortes de garanties quant à la vie et aux intérêts des habitants non ennemis de la révolution.
Cinquièmement – Pour subvenir aux besoins matériels des troupes et tant que cela sera possible, ils devront imposer des contributions de guerre aux négociants et aux propriétaires dans la zone où ils opèrent, dans la mesure où ceux-ci disposent d’importants capitaux, conformément à la LOI SUR LES IMPÔTS DE GUERRE et aux lois révolutionnaires d’affectation de capitaux commerciaux, agricoles, financiers et industriels.
Sixièmement – Les fonds matériels ainsi recueillis seront intégralement consacrés aux nécessités matérielles des troupes. Le chef ou l’officier qui détournerait une partie de ces fonds à des fins personnelles, si petite fut-elle, sera fait prisonnier et jugé, selon le règlement de l’EZLN, par un tribunal militaire révolutionnaire.
Septièmement – Concernant l’alimentation des troupes, la pâture des chevaux, le combustible et la réfection des véhicules, il faudra s’adresser à l’autorité démocratiquement élue des lieux concernés. Cette autorité recueillera parmi la population civile ce qu’il sera possible et nécessaire de recueillir pour l’unité militaire zapatiste, qu’elle remettra au chef ou au plus haut gradé de ladite unité et à lui seulement.
Huitièmement – Seuls les officiers d’un grade égal ou supérieur à celui de major veilleront au remplacement des autorités des lieux tombés sous le pouvoir de la révolution, conformément à la volonté du peuple et selon les dispositions de la LOI DE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE qui s’y réfèrent.
Neuvièmement – Les populations, en général, devront prendre possession de leurs biens en accord avec les Lois révolutionnaires. Les chefs ou officiers de l’EZLN offriront à ces populations leur soutien moral et matériel afin que soient appliquées ces Lois révolutionnaires, à condition que lesdites populations en fassent la demande — et seulement en ce cas.
Dixièmement – Absolument personne ne pourra procéder à des entrevues ou élaborer des traités avec le gouvernement oppresseur ou ses représentants, sans l’autorisation préalable du Commandement général de l’EZLN.
Loi sur les impôts de guerre
Dans les zones contrôlées par l’EZLN s’appliquera la suivante LOI SUR LES IMPÔTS DE GUERRE qu’il faudra faire valoir avec la force morale, politique et militaire de notre organisation révolutionnaire.
Premièrement – La LOI SUR LES IMPÔTS DE GUERRE entrera en vigueur dès qu’une unité militaire de l’EZLN opérera sur un territoire spécifique.
Deuxièmement – La LOI SUR LES IMPÔTS DE GUERRE concerne toute personne civile, nationale ou étrangère, établie ou de passage sur ledit territoire.
Troisièmement – La LOI SUR LES IMPÔTS DE GUERRE n’est pas obligatoire pour les civils vivant de leurs propres ressources sans exploiter la moindre force de travail, et sans tirer un quelconque profit du peuple. Pour les paysans pauvres, les journaliers, les ouvriers, les employés et les sans-emploi, l’obéissance à cette loi est volontaire, et on ne les y astreindra d’aucune façon, ni moralement ni physiquement.
Quatrièmement – La LOI SUR LES IMPÔTS DE GUERRE est obligatoire pour tous les civils qui vivent de l’exploitation de forces de travail ou qui tirent un quelconque profit du peuple dans leurs activités. Les petits, moyens et grands capitalistes de la campagne et de la ville pourront être astreints à se soumettre à cette loi sans exception, indépendamment de leurs obligations par rapport aux Lois révolutionnaires d’affectation de capitaux agricoles, commerciaux, financiers et industriels.
Cinquièmement – Sont établis les suivants pourcentages d’imposition selon le travail de chacun :
a / Pour les petits commerçants, les petits propriétaires, les ateliers et les petites industries, 7 % de leurs revenus mensuels. En aucune façon leurs moyens de production ne pourront être affectés au recouvrement de cet impôt.
b/ Pour les profesionistas, 10 % de leurs revenus mensuels. En aucune façon les moyens matériels strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ne pourront être affectés au recouvrement de cet impôt.
c / Pour les moyens propriétaires, 15 % de leurs revenus mensuels. Leurs biens seront affectés selon les Lois révolutionnaires afférentes d’affectation de capitaux agricoles, commerciaux, financiers et industriels.
d / Pour les grands capitalistes, 20 % de leurs revenus mensuels. Leurs biens seront affectés selon les Lois révolutionnaires afférentes d’affectation de capitaux agricoles, commerciaux, financiers et industriels.
Sixièmement – Tous les biens confisqués aux forces armées de l’ennemi seront propriété de l’EZLN.
Septièmement – Tous les biens obtenus des mains du gouvernement oppresseur par la Révolution seront propriété du gouvernement révolutionnaire, selon les lois du gouvernement révolutionnaire.
Huitièmement – Sont abolis tous les impôts et taxes du gouvernement oppresseur, ainsi que les dettes en argent ou en nature auxquelles le peuple exploité de la campagne et de la ville est assujetti par les gouvernants et les capitalistes.
Neuvièmement – Tous les impôts de guerre recueillis par les Forces armées révolutionnaires ou par le peuple organisé deviendront propriété collective des populations locales et seront administrés, selon la volonté populaire, par les autorités civiles démocratiquement élues, qui ne remettront à l’EZLN que le strict nécessaire pour répondre aux besoins matériels des troupes régulières et pour la perpétuation du mouvement libérateur conformément à la LOI DES DROITS ET DES DEVOIRS DES POPULATIONS EN LUTTE.
Dixièmement – Aucune autorité, civile ou militaire, qu’elle dépende du gouvernement oppresseur ou des Forces révolutionnaires, ne pourra prélever, pour son bénéfice personnel ou celui de sa famille, la moindre partie de ces impôts de guerre.
Loi des droits et des devoirs des populations en lutte
Au cours de sa progression libératrice sur le territoire mexicain et dans sa lutte contre le gouvernement oppresseur et les grands exploiteurs nationaux et étrangers, l’EZLN fera valoir, avec le soutien des populations en lutte, la suivante Loi des droits et des devoirs des populations en lutte :
Premièrement – Les populations en lutte contre le gouvernement oppresseur et les grands exploiteurs nationaux et étrangers, quelles que soient leur appartenance politique, religieuse, leur race ou leur couleur, bénéficieront des DROITS suivants :
- D’élire librement et démocratiquement leurs autorités, sous la forme qu’elles considéreront opportune, et d’exiger que celles-ci soient respectées.
- D’exiger des Forces armées révolutionnaires qu’elles n’interviennent pas dans les affaires d’ordre civil ou dans l’affectation des capitaux agricoles, commerciaux, financiers et industriels qui relèvent de la compétence exclusive des autorités civiles librement et démocratiquement élues.
- D’organiser et d’exercer la défense armée de leurs biens collectifs et particuliers, ainsi que d’organiser et d’exercer le maintien de l’ordre public et du bon gouvernement selon la volonté populaire.
- D’exiger des Forces armées révolutionnaires qu’elles assurent la sécurité de personnes, de familles et de propriétés particulières, de collectivités de voisins et de personnes de passage, dans la mesure où ce ne sont pas des ennemis de la révolution.
- Les habitants de toute agglomération ont le droit d’acquérir et de posséder des armes pour défendre leur personne, leur famille et leurs biens, conformément aux lois d’affectation des capitaux agricoles, commerciaux, financiers et industriels, contre les attaques ou les attentats que commettraient ou prétendraient commettre les Forces armées révolutionnaires ou celles du gouvernement oppresseur.
De la même manière, ils sont amplement fondés à faire usage de leurs armes contre tout homme ou groupe d’hommes qui s’en prendraient à leur foyer, à l’honneur de leur famille ou tenteraient de les voler ou de porter tout type d’atteinte à leur personne. Cela ne vaut que pour ceux qui ne sont pas ennemis de la révolution.
Deuxièmement – Les autorités civiles de tout type, démocratiquement élues, auront, en plus des droits précédents et des attributions que leur confèrent les lois révolutionnaires respectives, les DROITS suivants :
- Ils pourront emprisonner, désarmer et remettre à leur commandement quiconque sera surpris en train de cambrioler, de violer ou de saccager un domicile, ou en train de commettre tout autre délit, afin qu’il reçoive le châtiment qu’il mérite, y compris s’il s’agit d’un membre des Forces armées révolutionnaires. Il en ira de même pour ceux qui auraient commis de tels délits, même s’ils n’ont pas été pris sur le fait, dans la mesure où leur culpabilité sera suffisamment établie.
- Ils auront le droit de procéder au recouvrement des impôts révolutionnaires établis par la LOI DES IMPÔTS DE GUERRE.
Troisièmement – Les populations en lutte contre le gouvernement oppresseur et les grands exploiteurs nationaux et étrangers, quelles que soient leur appartenance politique, religieuse, leur race ou leur couleur, seront tenues aux DEVOIRS suivants :
- Offrir leur concours aux tâches de surveillance décidées par volonté majoritaire ou par les nécessités militaires de la guerre révolutionnaire.
- Répondre à l’appel des autorités démocratiquement élues, des Forces armées révolutionnaires ou de tout militaire révolutionnaire en cas d’urgence à combattre l’ennemi.
- Offrir leur concours pour l’acheminement du courrier ou en tant que guides des Forces armées révolutionnaires.
- Offrir leur concours pour porter des vivres aux troupes révolutionnaires lorsqu’elles sont au combat contre l’ennemi.
- Offrir leur concours pour le transport de blessés, l’enterrement de cadavres, et autres travaux de même nature relatifs à l’intérêt de la révolution.
- Procurer des vivres et l’hébergement aux Forces armées révolutionnaires, qu’elles soient en garnison ou de passage dans leur agglomération et dans la mesure de leurs possibilités.
- Payer les impôts et les contributions établies par les LOIS SUR LES IMPOTS DE GUERRE et les autres Lois révolutionnaires.
- Elles ne devront en aucune façon aider l’ennemi ni lui fournir de produits de première nécessité,
- Se consacrer à un travail licite.
Quatrièmement – Les autorités civiles de tout type, démocratiquement élues, auront, en plus des devoirs précédents, les OBLIGATIONS suivantes :
- Rendre compte régulièrement à la population des activités liées à leur mandat ainsi que de la provenance et de l’affectation de toutes les ressources matérielles et humaines placées sous leur administration.
- informer régulièrement leur commandement des Forces armées révolutionnaires des nouveaux événements qui se produisent sur leur territoire.
Loi des droits et des devoirs des Forces armées révolutionnaires
Les Forces armées révolutionnaires de l’EZLN, dans leur lutte contre le gouvernement oppresseur et les grands exploiteurs nationaux et étrangers, et au cours de leur progression libératrice sur le territoire mexicain, s’engagent à respecter et faire respecter la suivante LOI DES DROITS ET DES DEVOIRS DES FORCES ARMÉES RÉVOLUTIONNAIRES :
Premièrement – Les troupes révolutionnaires de l’EZLN, dans leur lutte contre l’oppresseur ont les DROITS suivants :
- Les troupes qui transitent ou séjournent dans une agglomération auront le droit de recevoir de la population, par l’intermédiaire des autorités démocratiquement élues, le logement, les vivres et les moyens d’accomplir leurs missions militaires, et cela dans la mesure des capacités des habitants de ladite agglomération.
- Les troupes qui, sur ordre de leur commandement, s’établiraient en un lieu précis auront le droit de recevoir le logement, les vivres et des moyens, conformément aux dispositions de l’alinéa a/ de cet article.
- Les chefs, officiers et soldats qui constateraient qu’une autorité n’applique pas les dispositions des Lois révolutionnaires et se dérobent à la volonté populaire auront le droit de dénoncer cette autorité auprès de leur gouvernement révolutionnaire.
Deuxièmement – Les troupes révolutionnaires de l’EZLN, dans leur lutte contre l’oppresseur, ont les DEVOIRS suivants :
- Faire en sorte que les populations qui n’ont pas encore nommé librement et démocratiquement leurs autorités procèdent immédiatement à la libre élection de celles-ci, sans intervention des forces armées, qui, sous la responsabilité de leurs dirigeants militaires, laisseront faire la population sans exercer la moindre pression
- Respecter les autorités civiles librement et démocratiquement élues.
- Ne pas intervenir dans les affaires civiles et laisser agit librement les autorités civiles dans ces affaires.
- Respecter le commerce légal en accord avec les Lois révolutionnaires s’y référant.
- Respecter les répartitions agricoles réalisées par le Gouvernement révolutionnaire.
- Respecter les règlements, coutumes et accords des populations et s’y soumettre dans les cas de relations entre militaires et civils.
- Ne pas imposer les habitants, sous aucune forme ni prétexte, sur l’utilisation de leurs terres et de leurs eaux.
- Ne pas s’approprier les terres de la population ou des grandes propriétés confisquées à l’oppresseur pour leur bénéfice personnel.
- Respecter toutes les lois et les règlements émis par le Gouvernement révolutionnaire.
- Ne pas exiger de la population des services personnels ou des travaux pour le bénéfice personnel.
- Dénoncer les subordonnés qui commettraient un délit, les capturer et les remettre à un Tribunal militaire révolutionnaire afin qu’ils y reçoivent un juste châtiment.
- Respecter la justice civile.
- Les chefs et officiers seront responsables devant leurs commandements respectifs des abus et des délits de leurs subordonnés qu’ils n’auront pas livrés aux Tribunaux militaires révolutionnaires.
- Faire la guerre à l’ennemi jusqu’à ce qu’il soit définitivement chassé du territoire convoité ou totalement anéanti.
Loi agraire révolutionnaire
Les paysans démunis en lutte au Mexique continuent de réclamer la terre pour ceux qui la travaillent. Après Emiliano Zapata et contre la réforme de l’article 27[4] de la Constitution mexicaine, l’EZLN reprend la juste lutte de la campagne mexicaine pour la terre et la liberté. Afin de réglementer la nouvelle répartition agraire qu’apporte la révolution sur les terres mexicain établie la suivante LOI AGRAIRE REVOLUTIONNAIRE:
Premièrement – Cette loi vaut pour tout le territoire mexicain et bénéficie à tous les paysans démunis et aux journaliers agricoles mexicains, sans distinction d’appartenance politique ou religion de sexe, de race ou de couleur.
Deuxièmement – Cette loi concerne toutes les propriétés et les entreprises agricoles nationales ou étrangères sur le territoire mexicain.
Troisièmement – Sera sujette à affectation agraire toute étendue de terrain excédant 100 hectares en mauvais état ou 50 hectares en bon état. Les propriétaires dont les terres excèdent les limites mentionnées ci-dessus seront dépossédés de leurs excédents et conserveront le minimum autorisé par cette loi ; ils pourront rester petits propriétaires ou se joindre au mouvement paysan de coopératives, de sociétés paysannes ou de terres communales.
Quatrièmement – Ne feront pas l’objet d’affectation agraire les terres communales, ejidos[5] ou terrains appartenant aux coopératives populaires, y compris si elles dépassent les limites mentionnées dans l’article 3 de cette loi.
Cinquièmement – Les terres affectées par cette loi seront réparties entre les paysans sans terre et les journaliers agricoles qui en feront la demande, sous forme de PROPRIÉTÉ COLLECTIVE par la formation de coopératives, de sociétés paysannes ou de collectifs de production agricole et d’élevage. Les terres ainsi affectées devront être travaillées en collectivité.
Sixièmement – Dans le cadre de cette répartition bénéficient d’un DROIT PRIORITAIRE les collectivités de paysans pauvre sans terre et de journaliers agricoles, hommes, femmes et enfants, qui pourront prouver qu’ils ne possèdent pas de terre ou alors de mauvaise qualité.
Septièmement – Pour l’exploitation de la terre au bénéfice des paysans pauvres et des journaliers agricoles, les affectations des grandes propriétés et des monopoles agricoles incluront les moyens de production tels que les machines, les fertilisants, les entrepôts, les ressources financières, les produits chimiques et l’assistance technique.
Tous ces moyens doivent passer aux mains des paysans pauvres et des journaliers agricoles avec une considération spéciale pour les groupes organisés en coopérative, en collectivité et en société.
Huitièmement – Les groupes bénéficiant de cette Loi agraire devront se consacrer de préférence à la production collective des aliments nécessaires au peuple mexicain : maïs, haricots, légumes frais et fruits, ainsi qu’à l’élevage bovin, apicole, ovin, porcin et chevalin, ou encore aux produits dérivés (viande, lait, œufs, etc.).
Neuvièmement – En temps de guerre, une partie de la production des terres concernées par la présente loi sera destinée au soutien des orphelins et des veuves de combattants révolutionnaires et au soutien des Forces révolutionnaires.
Dixièmement – L’objectif de la production collective est de satisfaire en premier lieu les nécessités du peuple, de former chez ceux qui en bénéficient la conscience collective du travail et de ses bienfaits et de créer des unités de production, de défense et d’entraide dans les campagnes mexicaines. Lorsqu’une région ne produit pas une certaine chose, on procédera à l’échange avec une autre région qui le fait, dans des conditions de justice et d’équité. Les excédents de production pourront être exportés vers d’autres pays s’il n’y a pas de demande nationale pour le produit concerné.
Onzièmement – Les grandes entreprises agricoles seront expropriées et passeront aux mains du peuple mexicain ; elles seront administrées collectivement par les travailleurs eux-mêmes. Les machines de labourage, de moissonnage, les semailles, etc., actuellement inutilisées dans les usines, les magasins ou ailleurs, seront distribuées entre les collectifs ruraux, afin d’amener à une production extensive de la terre et de commencer à éradiquer la faim du peuple.
Douzièmement – L’accaparement individuel des terres et des moyens de production ne sera pas toléré.
Treizièmement – Les zones de jungle vierge et les forêts seront préservées, et des campagnes de reboisage seront menées dans les zones principales.
Quatorzièmement – Les sources, rivières, lacs et mers sont propriété collective du peuple mexicain et seront entretenus en les préservant de la pollution et en punissant leur mauvaise utilisation.
Quinzièmement – Au bénéfice des paysans pauvres et des journaliers agricoles, en plus de la répartition agraire que la présente loi établit, seront créés des centres de commerce qui achèteront à juste prix les produits du paysan et vendront à juste prix les produits dont il a besoin pour vivre dignement. Seront créés des centres de santé communautaires dotés de tous les progrès de la médecine moderne, avec des médecins et des infirmières habilités et consciencieux, et avec des médicaments gratuits pour le peuple. Seront créés des centres de loisirs pour que les paysans et leurs familles profilent d’un repos digne, sans buvette ni maison de prostitution. Seront créés des centres d’éducation et des écoles gratuites où les paysans et leurs familles pourront s’éduquer, sans distinction d’âge, de sexe, de race ou d’appartenance politique, et apprendre les techniques nécessaires à leur développement. Seront créés des centres de construction de logements et de routes avec des ingénieurs, des architectes et les matériaux nécessaires afin que les paysans puissent avoir un logement digne et de bonnes routes pour les transports. Seront créés des centres de services pour garantir aux paysans et à leurs familles l’électricité, les canalisations d’eau potable, le drainage, la radio et la télévision, en plus de tout l’équipement nécessaire pour faciliter le travail domestique, radiateurs, réfrigérateurs, machines à laver, moulins à mais, etc.
Seizièmement – Seront exemptés d’impôts les paysans travaillant collectivement, les détenteurs des coopératives et les terres communales.
A PARTIR DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI AGRAIRE RÉVOLUTIONNAIRE SONT ABOLIES TOUTES LES DETTES ISSUES DE CRÉDITS, D’IMPÔTS OU DE PRÊTS CONTRACTES PAR LES PAYSANS PAUVRES ET LES JOURNALIERS AGRICOLES AUPRÈS DU GOUVERNEMENT OPPRESSEUR, DE L’ETRANGER OU DES CAPITALISTES.
Loi révolutionnaire sur les femmes
Dans sa juste lutte pour la libération de notre peuple, l’EZLN incorpore les femmes au mouvement révolutionnaire sans distinction de race, de croyance ou d’appartenance politique, avec pour seule condition qu’elles fassent leurs les revendications du peuple exploité et son engagement à faire respecter les lois et règlements de la révolution. En outre, prenant en compte la situation de la travailleuse du Mexique, sont intégrées ses justes revendications d’égalité et de justice dans la suivante LOI REVOLUTIONNAIRE SUR LES FEMMES :
Premièrement – Les femmes, sans distinction de race, de croyance, de couleur ou d’appartenance politique, ont le droit de participer à la lutte révolutionnaire aux lieux et degrés que déterminent leur volonté et capacité.
Deuxièmement – Les femmes ont le droit de travailler et de percevoir un juste salaire.
Troisièmement – Les femmes ont le droit de décider du nombre d’enfants qu’elles désirent et dont elles peuvent s’occuper.
Quatrièmement – Les femmes ont le droit de participer aux affaires de la communauté et d’y remplir des fonctions officielles si elles sont librement et démocratiquement élues.
Cinquièmement – Les femmes et leurs enfants ont droit à une ATTENTION PRIORITAIRE concernant la santé et l’alimentation.
Sixièmement – Les femmes ont droit à l’éducation.
Septièmement – Les femmes ont le droit de choisir librement leur conjoint ainsi que celui de ne pas être contraintes au mariage.
Huitièmement – Aucune femme ne pourra être battue ou physiquement maltraitée, que ce soit par sa famille ou par des étrangers. Les délits de viol ou de tentative de viol seront sévèrement punis.
Neuvièmement – Les femmes pourront occuper des fonctions de direction dans l’organisation et obtenir des grades militaires dans les Forces armées révolutionnaires.
Dixièmement – Les femmes auront tous les droits et les devoirs contenus dans les lois et les règlements révolutionnaires.
Loi de réforme urbaine
Dans les zones urbaines contrôlées par l’Armée zapatiste de Libération nationale entrent en vigueur les lois suivantes afin de procurer un logement digne aux familles démunies.
Premièrement – Les habitants propriétaires de leur maison ou de leur appartement cesseront de payer l’impôt foncier.
Deuxièmement – Les locataires qui occupent leur logement depuis plus de quinze ans cesseront de payer leur loyer jusqu’au triomphe du Gouvernement révolutionnaire et l’établissement d’une nouvelle législation.
Troisièmement – Les locataires qui occupent un logement depuis moins de quinze ans se contenteront de payer 10% des revenus du chef de famille, qu’ils cesseront de payer une fois atteint le seuil des quinze ans d’occupation du même endroit.
Quatrièmement – Les lots urbains déjà équipés des services publics pourront être immédiatement occupés, ce qui sera signalé aux autorités civiles librement et démocratiquement élues, pour y construire des logements, même de forme provisoire.
Cinquièmement – Les bâtiments publics vides et les grandes demeures pourront être occupés de façon provisoire par plusieurs familles après qu’on y aura établi des séparations intérieures. Pour cela, les autorités civiles nommeront des comités de voisins, qui effectueront les sélections entre les candidatures et attribueront les autorisations d’occupation selon les besoins et les moyens disponibles.
Loi du travail
Les lois suivantes s’ajouteront à la Loi fédérale du travail en vigueur dans les zones contrôlées par l’EZLN.
Premièrement – Les entreprises étrangères paieront leurs employés en monnaie nationale au tarif horaire équivalent à celui qu’elles pratiquent en dollars à l’étranger.
Deuxièmement – Les entreprises nationales devront augmenter les salaires de façon mensuelle selon le pourcentage que déterminera une Commission locale des prix et des salaires. Cette commission comprendra des représentants des travailleurs, des fermiers, des patrons, des commerçants et des autorités librement et démocratiquement élues.
Troisièmement – Tous les travailleurs de la campagne et villes bénéficieront d’une assistance médicale gratuite dans centre de santé, hôpital ou clinique, public ou privé. Les dépenses médicales seront à la charge du patron.
Quatrièmement – Tous les travailleurs auront le droit d’obtenir de l’entreprise pour laquelle ils travaillent une part d’actions incessibles, proportionnelle au nombre d’années d’ancienneté en supplément de leur traitement actuel. La valeur monétaire de ces actions pourra être exploitée à sa retraite par le travailleur, sa femme ou un bénéficiaire.
Loi sur l’industrie et le commerce
Premièrement – Les prix des produits de base seront régulés par une Commission locale des prix et des salaires. Cette commission comprendra des représentants des travailleurs, des fermiers, des patrons, des commerçants et des autorités librement et démocratiquement élues.
Deuxièmement – L’accaparement d’un quelconque produit est interdit. Les accapareurs seront arrêtés et remis aux autorités militaires sous l’accusation de délit de sabotage et de trahison envers la Patrie.
Troisièmement – Le magasin d’une localité devra assurer le ravitaillement en tortillas et en pain pour tous en temps de guerre.
Quatrièmement – Les entreprises et les commerces jugés improductifs par leurs patrons qui souhaiteraient les fermer et emporter les machines et les matières premières passeront aux mains des travailleurs pour leur administration, les machines devenant propriété de la nation.
Loi sur la sécurité sociale
Premièrement – Les enfants abandonnés seront alimentés et protégés par les plus proches voisins aux frais de l’EZLN avant d’être remis aux autorités civiles qui les prendront en charge jusqu’à l’âge de treize ans.
Deuxièmement – Les personnes âgées sans famille seront protégées et seront prioritaires pour l’attribution d’un logement et de coupons d’alimentation gratuite.
Troisièmement – Les mutilés de guerre recevront des soins et du travail en priorité, aux frais de l’EZLN.
Quatrièmement – La pension des retraités équivaudra au salaire minimum établi par les commissions locales des prix et des salaires.
Loi sur la justice
Premièrement – Tous les détenus en prison seront libérés, à l’exception des assassins, des violeurs et des dirigeants du trafic de drogue.
Deuxièmement – Tous les gouvernants, du président municipal jusqu’au président de la République, seront soumis à des auditions et jugés pour malversation de capitaux s’il existe des éléments de culpabilité.
VIVRE POUR LA PATRIE OU MOURIR POUR LA LIBERTÉ
[1] Tiré de l'ouvrage "Ya Basta! Les insurgés zapatistes racontent un an de révolte au Chiapas" Tome 1 paru en 1994 et reprenant les communiqués de l'EZLN rédigés par le sous-commandant Marcos.
[2] Personnes exerçant une profession libérale.
[3] Mexicains émigrés aux Etats-Unis.
[4] La Constitution de 1917 pose le principe fondamental de la propriété nationale de la terre et de toutes les ressources naturelles susceptibles d'utilisation agricole et instaure un droit de propriété communautaire des terres, Vejido. En novembre 1991, le gouvernement a fait voter en un temps record un amendement constitutionnel (article 27) déclarant révolue la réforme agraire et permettant l'appropriation privée et l'ouverture au capital étranger de l'agriculture et du secteur de Vejido.
[5] Parcelles communautaires incessibles attribuées à des paysans par Lazaro Cardenas dans les années trente, symbole des réformes zapatistes.